« Valoriser l’excellence des recherches des jeunes chercheurs en mécanique des solides et des matériaux » : trois questions à Samuel Forest sur le lancement du concours pour le Prix Jean Mandel 2025


Créé en hommage à Jean Mandel (1907-1982), éminent chercheur et professeur à Mines Paris – PSL et à l’École Polytechnique, le Prix Jean Mandel célèbre les avancées remarquables dans les domaines de la mécanique des solides et des matériaux. Jean Mandel, pionnier de la plasticité des métaux et des sols, a marqué durablement ces disciplines grâce à ses travaux sur l’élasto-plasticité, la rhéologie et la modélisation des structures. Depuis 1982, ce prix bisannuel incarne son héritage en récompensant les chercheurs prometteurs qui contribuent à l’essor des sciences mécaniques.
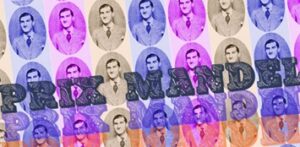
Le Prix Jean Mandel valorise des travaux de haut niveau, qu’ils soient théoriques, expérimentaux ou appliqués. Il s’adresse aux jeunes chercheurs ou équipes répondant à des critères d’excellence scientifique et ayant un impact significatif sur des secteurs clés comme l’énergie, les transports ou la construction. Ce prix perpétue la vision de Jean Mandel et stimule le rayonnement de la recherche française.

Le concours est organisé par le Laboratoire de Mécanique des Solides de l’École Polytechnique (sous la direction d’Andrei Constantinescu) et le Centre des Matériaux de Mines Paris – PSL (dirigé par Jérôme Crépin). Les coordinateurs, Eric Charkaluk et Samuel Forest, veillent à garantir l’excellence scientifique du processus de sélection.
Pour participer, les candidats doivent :
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 février 2025.
Les dossiers doivent inclure :
Les documents doivent être envoyés au format PDF à Samuel Forest, secrétaire du jury (samuel.forest@minesparis.psl.eu). Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, une recommandation par une personnalité scientifique est vivement encouragée.
Le prix, doté de 8 000 euros, sera remis lors du Congrès Français de Mécanique à Metz (25-29 août 2025), où les lauréats auront l’opportunité de présenter leurs travaux.

Lauréat lui-même avant de devenir coordinateur du prix, Samuel Forest est un spécialiste de la mécanique des matériaux et de la modélisation multi-échelle. Ses contributions à l’étude du comportement viscoplastique des métaux et des structures sont devenues des références dans le domaine.
Jean Mandel a ouvert des pistes de recherches qui sont toujours d’une brûlante actualité. Ses résultats théoriques en mécanique des matériaux hétérogènes sont à la base de la modélisation du comportement des matériaux composites aujourd’hui largement répandus dans les composants industriels de structures aéronautiques et automobiles. Un autre aspect important est la modélisation de la plasticité des matériaux cristallins, en particulier métalliques. Son modèle des grandes déformations élastoplastiques anisotropes est aujourd’hui le standard international. Il permet de simuler la mise en forme et la transformation des alliages métalliques, telles que le laminage des tôles d’acier et d’aluminium, procédé stratégique des industries de transformation. Enfin, ses résultats sur la prévision de la ruine des matériaux et des sols par la formation de bandes de cisaillement ou de localisation de la plasticité et de l’endommagement, inspirent la formulation des critères actuels d’instabilité des structures et de rupture des matériaux. Ces sujets sont d’une redoutable difficulté en raison de la variété des mécanismes physiques de déformation et d’endommagement à l’œuvre dans les différentes classes de matériaux. Cela explique l’actualité de l’héritage de Jean Mandel.
Traditionnellement, le jury du prix apprécie la rigueur de la démarche scientifique en mécanique alliant aspects mathématiques, physiques, numériques et expérimentaux pour caractériser le comportement des matériaux et des structures. Plusieurs thèmes importants ont été mis à l’honneur au cours des dernières éditions du prix. La mécanique du contact, par exemple, a pour objet l’analyse des interactions entre corps déformables, le frottement entre surfaces en contact et la nature physique de la rugosité des surfaces permettant d’en optimiser les propriétés d’usure notamment. La fabrication additive permet aujourd’hui de concevoir des matériaux architecturés sur mesure en vue de propriétés visées et de les fabriquer, en allant au-delà des structures usuelles en nid d’abeilles. Signalons enfin la mécanique de l’endommagement et de la rupture qui vise à prévoir la formation et la propagation des fissures dans les matériaux et les structures. Quelle est la vitesse de propagation d’une fissure de fatigue dans un disque de turbine de moteur d’avion, ou dans un composant interne en acier de cuve de réacteur nucléaire? Des questions de durabilité essentielles à la société et toujours largement ouvertes et fascinantes du point de vue scientifique, malgré des progrès remarquables depuis cinquante ans!
Le prix Jean Mandel, depuis sa création en 1982, est un prix prestigieux dont peuvent s’enorgueillir les jeunes lauréats et leurs laboratoires d’appartenance. Il suffit de juger des carrières remarquables des lauréats passés. La recherche française en mécanique des matériaux et des structures jouit d’une large reconnaissance internationale depuis cinquante ans, notamment grâce au rôle pionnier de chercheurs français qui ont marqué la discipline : Jean Mandel, Paul Germain puis Jean Lemaitre, Jean-Louis Chaboche, André Pineau, André Zaoui, Dominique François, etc. Les jeunes chercheurs font preuve d’une inspiration toujours aussi forte et leurs contributions aujourd’hui continuent de susciter l’intérêt de la communauté internationale, notamment au travers d’articles scientifiques de qualité. L’origine de ce succès est la conjonction des demandes de la société et de l’industrie et de la richesse scientifique physique et mécanique des questions concernant la maîtrise de la durabilité des structures et composants industriels de notre quotidien.
Depuis sa création, le prix a récompensé de nombreux chercheurs qui ont marqué leur domaine. Parmi eux :
François Mudry (1983)
Développeur de l’approche locale de la rupture avec André Pineau qui vise à faire le lien entre la microstructure des matériaux et leur résistance à la rupture, François Mudry a été Directeur des Recherches à l’Ecole des Mines de Paris, puis Directeur scientifique à Arcelor-Mittal. Il est aujourd’hui membre de l’Académie des Technologies.
Jean-François Agassant (1984)
Spécialiste des procédés de mise en œuvre et de la rhéologie des polymères, Jean-François Agassant est professeur à l’Ecole des Mines de Paris. Il a formé des générations d’étudiants en sciences et génie des matériaux dans le cadre d’une option et d’un master à l’Ecole des Mines.
Pierre Suquet (1988)
Reconnu pour ses travaux en mécanique des milieux continus, Pierre Suquet a apporté des avancées majeures dans l’homogénéisation des matériaux hétérogènes. Ses recherches ont eu un impact significatif sur la compréhension des comportements mécaniques complexes, avec des applications dans les matériaux composites et les structures avancées.
Nicolas Moës et Marc Fivel (2003)
Ces deux chercheurs ont été récompensés pour leurs avancées en mécanique numérique. Nicolas Moës, aujourd’hui membre de l’Académie des sciences, est connu pour la méthode des éléments finis étendus (XFEM), qui révolutionne les simulations des fissures et de la rupture. Marc Fivel, quant à lui, s’est distingué dans la modélisation de la plasticité des métaux par une approche aux petites échelles incluant les défauts du cristal que sont les dislocations.
Jérémy Bleyer et Vladislav Yastrebov (2023)
Lauréats récents, leurs recherches combinent des approches numériques et expérimentales pour explorer les comportements des matériaux à l’échelle microscopique et macroscopique. Ces travaux ouvrent des perspectives prometteuses pour l’optimisation des matériaux et des structures avancées.

Henry Proudhon, chercheur au Centre des Matériaux (CMAT) de Mines Paris – PSL, sera honoré par le prix David Embury 2024 de la Société Française de Mé...