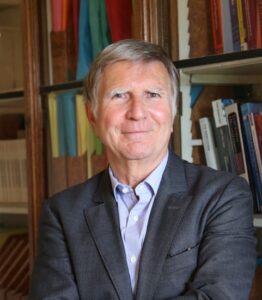Dans cet ouvrage, les auteurs examinent les solutions d’adaptation nécessaires pour protéger des vies, limiter les dégâts économiques et réduire les inégalités face à ces bouleversements.
À travers un entretien croisé, ils partagent les réflexions qui ont guidé leur démarche, offrant une analyse critique des politiques publiques et de la contribution des stratégies disponibles à la gestion des crises climatiques. Une invitation à repenser l’adaptation comme une action essentielle pour faire face aux crises climatiques.
L’adaptation est au cœur de votre livre, décrite à la fois comme une urgence et une opportunité. Pourquoi ce choix d’approche de l’adaptation, qui peut susciter des réserves face à l’atténuation ?
Il est vrai que l’adaptation a longtemps eu mauvaise presse, certains craignant qu’elle décourage les efforts de réduction des émissions de carbone. Cette opposition n’a plus lieu d’être. Si l’atténuation traite les causes, l’adaptation offre des solutions à même de gérer l’urgence. Semer du sorgho au printemps pour mieux résister à la sècheresse estivale – cette céréale consomme moins d’eau que le maïs – a un effet sur la récolte qui va suivre. Installer une fenêtre de toit dans une maison localisée au bord de l’eau pour créer un refuge en cas d’inondations catastrophiques diminue immédiatement les risques de noyade. Du fait de l’inertie du système climatique, les bénéfices de l’atténuation prennent eux plus de temps à se manifester. Et ils dépendent d’un effort mondial, conditionné par des négociations climatiques internationales longues et aux résultats incertains. Les retraits répétés des États-Unis des accords climatiques ne cessent de l’illustrer.

En 2017, les États-Unis se retirent des accords de Paris.
Vous affirmez que les politiques publiques sont essentielles pour accompagner l’adaptation, notamment en orientant les choix individuels. Quelles actions prioritaires doivent être mises en œuvre par les gouvernements pour maximiser les bénéfices de l’adaptation ?
Pour nous, la première des priorités est paradoxalement d’accélérer l’atténuation et, plus généralement, de renforcer les actions de protection de l’environnement et de gestion des ressources naturelles. Parce qu’ils en retirent des bénéfices pour eux-mêmes, plus de confort ou de productivité, plus de résilience face aux évènements extrêmes, les entreprises, les ménages, les agriculteurs ont déjà commencé à s’adapter. Or les stratégies les plus simples à mettre en œuvre sont souvent émettrices de carbone. Prenons l’exemple de la climatisation en Inde. Dans ce pays, beaucoup plus exposé que nous ne le sommes aux températures extrêmes, vont être installés dans les années qui viennent quelques centaines de millions de climatiseurs sous l’effet combiné du réchauffement climatique et d’une croissance économique qui fournit à une part croissante de la population les moyens de les financer. Or, si la solution est très efficace pour rafraîchir la température intérieure des bâtiments, elle émet beaucoup de gaz à effet de serre quand l’électricité qui l’alimente est produite avec des énergies fossiles. C’est le cas aujourd’hui en Inde : les trois-quarts de l’électricité consommée dans le pays proviennent de centrales à charbon. Sans transition énergétique, le coût environnemental de cette adaptation peut alors devenir gigantesque. À l’inverse, une politique de décarbonation résolue peut fournir les moyens de résister aux vagues de chaleur qui vont se multiplier. Cette nécessité de renforcer l’action publique pour accompagner l’adaptation vaut pour d’autres politiques environnementales, notamment la prévention des risques naturels et la gestion de la ressource en eau.

La demande croissante de climatisation dans les pays du Sud, comme ici à Mumbai en Inde, suscite des inquiétudes quant au dérèglement climatique.
Seconde priorité, la production et la diffusion d’information. L’adaptation résulte de décisions prises par une myriade d’acteurs : ménages, autorités publiques locales et nationales, entreprises etc. Or, leurs choix ne peuvent être pertinents que s’ils reposent sur une information fiable sur les risques climatiques. Cela vaut pour l’urgence. Le bilan humain désastreux des récentes inondations à Valence en Espagne, environ deux-cent-trente morts et disparus, s’explique notamment par la défaillance de la chaîne d’alerte qui a conduit de nombreux habitants sous-informés à prendre leur voiture ce matin-là. Les décisions de plus long terme, l’implantation de digues ou leur renforcement par exemple, nécessitent une information à un niveau géographique très fin et des projections à des horizons temporels variés. La mettre à disposition au bon endroit, au bon moment, auprès des acteurs pertinents et sous une forme assimilable facilement est une mission fondamentale de la puissance publique.
Vous insistez beaucoup dans l’ouvrage sur les effets potentiellement délétères de l’adaptation sur les inégalités sociales et la pauvreté. Quels sont, selon vous, les écueils les plus importants à éviter pour garantir une adaptation juste ?
Le problème est que la capacité à s’adapter est plus fortement déterminée par la richesse que par les besoins. Construire des digues, installer des climatiseurs, investir dans des dispositifs d’alerte et de prévision des évènements climatiques extrêmes ou des infrastructures nécessitent en effet des ressources financières. Au niveau international, c’est alors la double peine pour les pays moins avancés du Sud qui cumulent une forte exposition du fait de leur localisation aux basses latitudes et des capacités d’adaptation limitées pour y faire face. C’est dans ces régions que se jouent la possibilité d’un effondrement face au changement climatique, plus que dans le monde développé disposant des moyens pour l’éviter. D’où la question cruciale dans la négociation climatique du financement de l’adaptation par les pays plus riches, les pays industrialisés, la Chine ou les États pétroliers du golfe. Les discussions lors de la COP 29 qui viennent de se terminer à Bakou n’ont malheureusement pas fait beaucoup progresser le sujet. Les pays occidentaux n’ont accepté qu’un financement de 300 milliards par an, très inférieur aux besoins des pays les plus pauvres de la planète.

Des ONG font pression pour augmenter l’objectif financier mondial, lors de la COP 29.
Au niveau national, la question se pose un peu différemment dans la mesure où les plus vulnérables ne sont pas toujours les plus exposés. L’INSEE nous apprend ainsi qu’un habitant sur sept vit dans un territoire qui subira plus de 20 jours de canicule dans les décennies à venir, mais la proportion de ménages modestes y est inférieure à la moyenne nationale. Autre exemple, les épisodes de submersions marines appelés à se multiplier en France avec l’augmentation du niveau de la mer concerneront des populations plutôt aisées. Un constat peu surprenant pour qui connait le prix d’une résidence en bord de mer. À ce niveau, la sélectivité de l’action publique est essentielle. Il s’agit moins de protéger les plus exposés que les plus vulnérables.
À propos