Conférence ISIGE alumni : l’économie circulaire
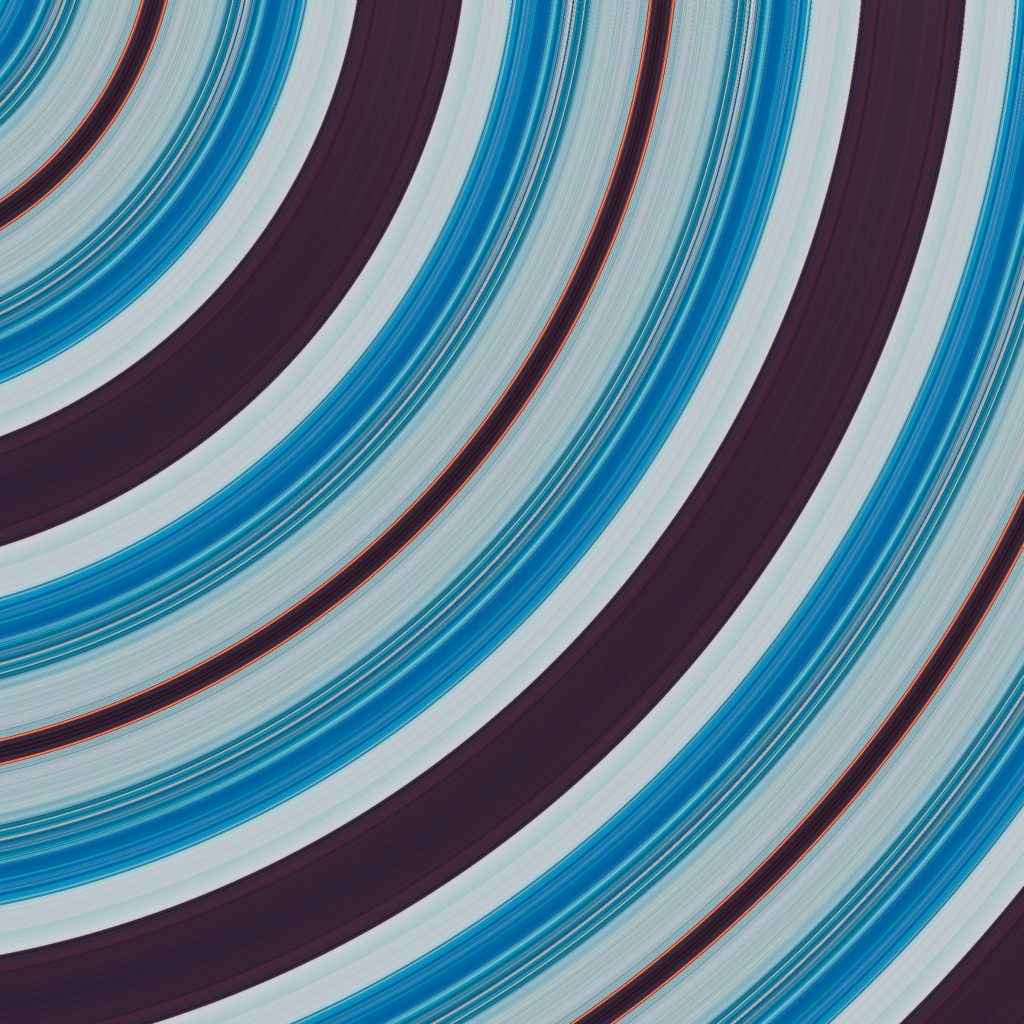
En amont de la publication de la Feuille de route de l’Économie circulaire prévue le 31 mars 2018 qui s’inscrit dans le cadre du Plan Climat présenté par Nicolas Hulot, ISIGE Alumni organise une conférence-table ronde, le mardi 6 mars 2018, sur le thème : « Économie circulaire : quelles perspectives et quelles dynamiques suite à la feuille de route du gouvernement ? »
Des experts vous apporteront leur éclairage sur les mesures (techniques, réglementaires, sociales, financières) préconisées par cette Feuille de route, afin de mieux appréhender les changements et les nouvelles opportunités à venir dans le domaine de l’Économie circulaire. Le panel de nos intervenant-e-s est composé de personnalités du monde politique, académique/recherche, institutionnel et économique.
Compte-rendu de la conférence sur l’Économie Circulaire rédigé par Kim Nguyen et Clémence Lestra
Dans le contexte des 25 ans du mastère IGE et de l’ISIGE, et des 10 ans des mastères RSEDD et ENVIM, l’association des anciens de l’ISIGE (ISIGE Alumni) a organisé, le mardi 6 mars dernier, sa conférence annuelle. Les intervenants présents ont été: Hélène Valade (directrice du Développement Durable chez SUEZ), Laetitia Vasseur (co-fondatrice et déléguée générale de HOP/ Halte à l’Obsolescence Programmée), Franck Aggeri (professeur au Centre de Gestion Scientifique de Mines ParisTech), Valérie David (directrice du Développement Durable d’Eiffage), Thierry Kuhn (président d’Emmaüs France) et Matthieu Orphelin (député de Maine-et-Loire et ambassadeur de la feuille de route pour l’Économie Circulaire). Cette conférence portait sur l’économie circulaire ainsi que sur la feuille de route que le gouvernement met actuellement en place sur le sujet.

Bref rappel : qu’est-ce que l’économie circulaire aujourd’hui?
Franck Aggeri définit l’économie circulaire comme une belle utopie: c’est ce qui fait sa force, par son caractère mobilisateur. C’est aussi et avant tout une utopie qu’il définit comme réaliste et rationnelle. On oppose régulièrement le concept d’économie circulaire à l’économie linéaire, symptomatique d’un modèle où l’on va extraire, produire consommer et jeter des ressources. L’économie circulaire permet au contraire de boucler les flux de matière et d’énergie en appliquant la règle des “3R” : réduire, réutiliser et recycler les matières avant tout.
Il s’agit d’un concept faussement nouveau. Il a toujours été coutume de réutiliser les matériaux jusqu’à l’avènement de la société de consommation au milieu du 20e siècle. La notion de déchet dans le vocabulaire politique et juridique se développe aux 19 et 20e siècles, traduisant l’évolution du monde de la consommation.
Le premier modèle de consommation antérieur au XXe siècle, a progressivement disparu pour trois raisons : le progrès technique, le développement de l’hygiénisme et le développement du marketing et du design. L’enjeu de l’économie circulaire, telle que perçue aujourd’hui, ne sera pas de revenir vers le modèle ancien, mais plutôt d’inventer une nouveau modèle respectant des normes d’hygiène, de traçabilité, tout en évitant la surconsommation.
Changer de modèle : les principaux freins
La première partie de cette conférence a été consacrée aux freins que les intervenants identifient à la mise en place généralisée de l’économie circulaire dans notre société actuelle. Un manque d’informations et de sensibilisation ? Franck Aggeri introduit comme premier frein à la transition vers une économie circulaire, notre mode de consommation ancré sur l’économie linéaire. La réparabilité et recyclabilité sont, par exemple, encore très peu utilisés et valorisés dans notre société. De plus, certaines filières reposent sur des PME et le déploiement à une échelle plus large de l’économie circulaire nécessiterait l’initiative de politiques publiques. Thierry Kuhn a complété ce propos : la réticence de certains consommateurs à utiliser des produits de seconde main est un véritable frein dans notre société actuelle. Il établit un lien entre la volonté politique et la sensibilisation des consommateurs à l’économie circulaire.
En effet, malgré les bénéfices de la réparabilité, Lætitia Vasseur a expliqué les limites du modèle de réparation qui peut engendrer des coûts élevés ou qui nécessite des données techniques non disponibles. Elle dénonce également l’obsolescence programmée qui ne permet pas la réparation d’un produit, ou encore le manque de confiance des consommateurs vis-à-vis des réparateurs.
Surconsommation : à qui la faute ?
Un levier majeur dans la mise en place d’un système d’économie circulaire réside dans la limitation de la surconsommation. Désignée comme responsable du gaspillage et de la forte génération de déchets, elle est pourtant caractéristique de notre société contemporaine. Alors comment expliquer ce phénomène ? Afin d’illustrer la responsabilité du consommateur, Hélène Valade a comparé la relation du consommateur à l’économie circulaire à une “schizophrénie”. En effet, les consommateurs sont dans l’attente de mesures concrètes provenant de l’action publique et d’une réelle avancée dans le déploiement de l’économie circulaire. Pourtant, la consommation ne cesse de croître exponentiellement – une réelle contradiction dans notre mode de pensée.
Avec le constat d’une consommation qui ne cesse de croître, Matthieu Orphelin met en avant l’urgence de développer rapidement l’économie circulaire, au risque de se confronter à l’épuisement des ressources. Il y a une nécessité deAvec le constat d’une consommation qui ne cesse de croître, Matthieu Orphelin met en avant l’urgence de développer rapidement l’économie circulaire, au risque de se confronter à l’épuisement des ressources. Il y a une nécessité de responsabiliser consommateurs et entreprises à une échelle globale. En particulier, le manque d’implication des entreprises peut considérablement ralentir les initiatives en termes d’économie circulaire. Cela s’illustre, par exemple, par l’échec de l’opération de l’ADEME sur la réutilisation des déchets d’énergie. Malgré un gain moyen annuel estimé à 50 000€ pour un diagnostic estimé à 5 000€, seulement 100 entreprises ont répondu à ce projet sur les 5000 sollicitées. La diffusion de l’économie circulaire relève pour une part de la responsabilité de l’entreprise.
La responsabilité de l’entreprise ne doit pas pour autant se limiter à la mise en place d’une politique d’économie circulaire en interne. La démarche d’économie circulaire doit s’ancrer dans l’ADN de l’entreprise et être pensée en amont de la chaîne de production comme le souligne Thierry Kuhn. La mise en place de l’économie circulaire devrait débuter par la prévention et réduction de la production de déchets et être consolidée par la démarche de réemploi. Il assimile le réemploi à un levier de la mobilisation citoyenne où chacun pourrait trouver une opportunité et développer ses compétences.
Lætitia Vasseur insiste sur la nécessité de sensibiliser les consommateurs au pouvoir et impact que leurs actes peuvent avoir. Toutefois, la prise de conscience ne cesse de croître et l’étude canadienne du CESE a démontré que les consommateurs sont prêts à payer 20% plus chers un produit s’il est durable. Ainsi, le consommateur n’est pas l’unique responsable et les autres acteurs ne peuvent pas se dédouaner de leurs responsabilités, en développant, par exemple, des stratégies de marketing qui poussent à la consommation via l’obsolescence esthétique. En effet, si un produit n’a pas été conçu pour durer, l’utilisateur ne pourra pas malgré lui le préserver dans le temps. Le producteur doit s’engager à produire un bien durable, réparable et robuste. L’écoconception devrait être intégrée dans le processus de fabrication dès le prototype du produit.
L’action publique : acteur clé de la transition vers un nouveau modèle
Plusieurs intervenants ont ensuite souligné la nécessité d’une action publique engagée dans la mise en place de mesures permettant non seulement de favoriser l’économie circulaire auprès des acteurs, mais aussi de l’imposer comme modèle normatif. Valérie David prend l’exemple du secteur du bâtiment : si, dans la commande publique par exemple, il devient obligatoire d’intégrer des principes d’économie circulaire, ce modèle sortirait de l’ “exception” dans un domaine où les acteurs sont multiples et dont les priorités divergent parfois. Les leviers d’action sont variés : dons de matériaux de déconstruction aux associations, créations de plateformes et bourses d’échange pour le réemploi, mise en place d’une note relative à l’économie circulaire occupant une place prépondérante dans le cahier des charges, mise à disposition de foncier pour stocker les matériaux… Le rôle des élus est crucial pour donner un réel élan dans le secteur du BTP. Elle conclut ainsi en arguant que manque de règlementation est un réel frein pour les entreprises, et empêche les initiatives et la prise de connaissances d’opportunités en matière de recyclage ou de réemploi.
A ce sujet, lui même élu, Matthieu Orphelin acquiesce et ajoute que le plus important aujourd’hui pour que tous les acteurs s’engagent, est de convaincre qu’il coûterait moins cher de réutiliser ou réemployer, que de mettre directement en décharge. L’argument économique demeure essentiel pour changer le comportement des entreprises. A ce sujet, Franck Aggeri argumente que les marchés de recyclage et de réemploi offrent des opportunités économiques pour les entreprises, notamment pour celles qui produisent en France. Il peut y avoir un avantage compétitif à fournir des services et à mettre à profit son maillage territorial. A l’image de l’entreprise SEB, qui propose des services associés aux objets qu’elle produit, cela représente de réelles possibilités de réindustrialisation nationale, lorsque l’on privilégie l’économie circulaire. Thierry Kuhn ajoute qu’Emmaüs est constitué de 283 groupes en France et de 5000 emplois sur l’activité de réemploi et que l’ADEME estime à 70 000 emplois dans le réemploi.
Il est avant tout nécessaire d’avoir une politique gouvernementale cohérente. Lætitia Vasseur déplore à cet égard une forme de schizophrénie du gouvernement, où Bercy freine les actions du ministère de la Transition. Sur l’écoconception, il est nécessaire d’aller beaucoup plus loin : il n’est pas normal que le consommateur ne soit toujours pas en mesure de connaître le nombre d’usages dont un produit (machine à laver par exemple) a fait l’objet. Cela joue en défaveur de l’économie circulaire et pose de vrais problèmes de transparence. Le gouvernement doit aussi se doter de moyens de contrôle accrus pour l’application de la garantie de deux ans : une vraie plateforme, reliée à la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) pourrait par exemple permettre d’octroyer au consommateur un moyen de pression supplémentaire. Ainsi, favoriser l’économie circulaire nécessite un engagement de l’ensemble des ministères qui composent le gouvernement, car le changement de modèle intervient sur une échelle bien plus large que le seul ministère de la Transition écologique et solidaire. Selon Hélène Valade, enfin, l’action publique peut gagner en efficacité en se focalisant sur l’échelle territoriale. Selon elle, on gagnerait à embarquer davantage les territorialités locales pour développer l’économie circulaire. Au sein de cette échelle, l’expérimentation foisonne mais elle ne se fait pas assez entendre. Elle préconise alors une démarche bottom-up pour que les innovations viennent d’en bas, ainsi qu’un droit à l’expérimentation. Franck Aggeri appuie son propos, en préconisant de développer une réelle politique industrielle, à développer de manière plus territorialisée avec potentiellement une remise au goût du jour de la planification territoriale.
Quelle place pour le numérique afin d’opérer la transition vers l’économie circulaire ?
La place du numérique n’est pas un sujet traité dans la feuille de route, comme l’affirme Matthieu Orphelin; c’est toutefois, selon lui, un levier majeur. A titre d’exemple, l’ADEME et les grandes surfaces de supermarchés ont lancé une opération basée sur le Big Data pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Laetitia Vasseur, toutefois, émet un constat certes enthousiaste, mais plus réservé : attention à ce que la digitalisation ne prenne pas le pas sur les visions traditionnelles : un objet connecté remplaçant un objet low tech produit aussi des pollutions donc il faut se méfier. L’obsolescence logicielle existe aussi.
Basculer au système de fiscalité : au lieu de détaxer le réemploi, ne pourrait-on pas taxer les produits neufs ?
Enfin, une question sur un système de fiscalité défavorable aux produits neufs a été posée pour clôturer la conférence. Selon Hélène Valade, aller vers une fiscalité pénalisant les externalités négatives serait l’idéal. C’est un sujet qui a commencé à être pris en compte et qui ouvre des possibilités pour l’économie et la filière de valorisation matière. Mais cela demeure de l’ordre de la réflexion. Lætitia Vasseur ajoute qu’il ne faut pas s’interdire d’innover et de proposer : HOP en a proposé une innovation sur la réparation. Via des éco-contributions, il serait possible de créer un système vertueux où le consommateur paierait 50% de sa réparation, et 50% serait financé par un fonds qui proviendrait de cette contribution. Il y aurait un système de bonus malus pour la participation des entreprises.
Conclusion
La nécessité de sortir de cette économie dite linéaire n’a pas fait débat, et cette conférence a été enrichissante en ce qu’elle a su démontrer les enjeux de la mise en place d’un nouveau modèle économique davantage centré sur la soutenabilité et la durabilité, tout en mettant en avant la dimension multiscalaire de l’économie circulaire. En effet, les actions et initiatives doivent s’opérer sur les plusieurs échelles de territoires qui composent notre société, en intégrant l’ensemble des acteurs, qu’ils soient privés ou publics. L’urgence d’opérer une transition rend Thierry Kuhn plutôt optimiste : “nous avons la possibilité de sortir de cette économie linéaire pour tenir compte des enjeux climatiques, tout en créant des opportunités de création d’emploi.” Reste à voir si, le 31 mars prochain, la feuille de route pour l’économie circulaire du gouvernement se dotera de réels moyens d’action pour opérer cette transition avec succès.

De gauche à droite : Cécile Donat, Clément Fournier, Laetitia Vasseur, Matthieu Orphelin, Franck Aggeri, Hélène Valade, Claire Tutenuit, Sériane Kénéma, Valérie Lenglart, Quynh Bui, Valérie David, Jasha Oosterbaan et Alice Etienne


